« Liker » est un acte politique
Aujourd’hui, chaque clic sur un bouton « like » ou « partager » sur les réseaux sociaux influe discrètement mais puissamment sur les algorithmes des moteurs de recherche, et donc sur le paysage numérique, politique et social. Ce simple geste, souvent perçu comme un acte de soutien passif ou d’approbation, agit pourtant comme un mécanisme amplificateur, propulsant certaines informations dans les univers virtuels. Le « like » confère de la visibilité, hisse des messages au sommet des fils d’actualité et oriente ainsi la conversation publique. Au-delà de l’acte individuel, « liker » constitue en réalité une action aux répercussions collectives. C’est un acte politique.
Le « like » : nouvelle forme de pétition
Les manifestations et les pétitions traditionnelles existent depuis longtemps pour permettre aux citoyens d’exprimer leurs opinions, et de les imposer aux pouvoirs politiques. Sur les réseaux sociaux, chaque publication est une sorte de pétition numérique, et chaque « like » ou partage agit comme une signature symbolique. Ainsi, les posts qui reçoivent le plus de « likes » s’élèvent dans la hiérarchie algorithmique, leur conférant une plus grande visibilité.
Comme l’affirme une étude du Pew Research Center, « les interactions sur les réseaux sociaux modifient la perception publique des sujets d’importance ». Trop souvent ces « like » se font au profit de ceux qui suscitent les émotions les plus fortes. Les « likes » amplifient les voix populaires, mais orientent également les discussions vers des sujets et des valeurs partagées par les publics. Les réseaux sociaux, par leurs algorithmes de recommandation, valorisent les contenus qui génèrent le plus d’engagement, souvent par des réactions émotionnelles. Dans ce contexte, « liker » une publication revient à la hisser sur la scène publique et à lui conférer une légitimité politique.
Donc : le système des « likes » favorise la mise en avant des populismes, des extrémismes et fait de « l’émotion forte » le gouvernail de nos politiques modernes.
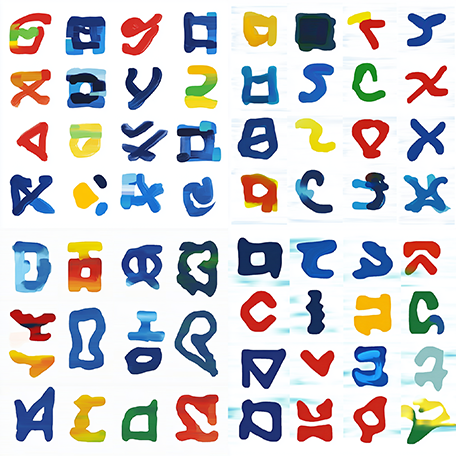
L’algorithme : qui décide de ce que l’on voit ?
La puissance du « like » s’explique surtout par le fonctionnement des algorithmes qui dominent les plateformes sociales. Sur Instagram, Facebook, ou même YouTube, l’engagement de l’utilisateur est au cœur du modèle de visibilité. En « likant » une publication, l’utilisateur envoie un signal aux algorithmes, qui l’interprètent comme une preuve de pertinence. Ce post, désormais jugé populaire, sera plus largement diffusé. Les réseaux sociaux deviennent alors les courroies de transmission de contenus approuvés par la masse, mais une masse sans visée politique et déresponsabilisée. Les jeunes, les extrêmes et les acteurs financiers (sociétés, lobbys, pirates informatiques) étant les plus enclins à « liker ». Nous leur laissons donc le pouvoir en ligne, et un contrôle certain sur nos cerveaux et ceux de nos enfants.
Des freins à l’engagement : les défis du « like »
Tout le monde n’interagit pas de la même manière sur les réseaux sociaux, et des freins au « like » existent. La discrétion en ligne, la pression sociale, la protection des données personnelles, beaucoup hésitent à « liker » par crainte du jugement de leurs contacts. La méfiance envers les univers numériques, la peur de perdre le contrôle sur un univers qu’ils maîtrisent peu, celle des géants de la technologies, ou encore la peur du harcèlement numérique freinent également la pratique du like. La défiance envers les réseaux sociaux, justifiée, tient à distance les acteurs de l’environnement numérique.
Pour les jeunes publics, cependant, ces barrières sont plus facilement franchissables, ce qui explique en partie pourquoi les contenus qui les concernent spécifiquement – les vidéos humoristiques, les tendances virales, les images choc – circulent plus rapidement que des sujets plus « sérieux ». Les freins au « like » deviennent donc des filtres sélectifs, qui déterminent quels types de contenus dominent le paysage numérique.
Ce sont ceux qu’il faudrait le plus entendre en ligne qui sont le moins présents.
Le rôle des lobbys et des extrêmes dans la course aux « likes »
Les lobbys et les organisations politiques, conscientes de l’impact du « like », investissent également pour influencer les opinions. Selon une étude de l’Université de New York, plus de la moitié des entreprises sont prêtes à payer pour générer des « likes » sur des publications, exploitant ainsi la visibilité algorithme pour servir leurs intérêts . Les groupes extrémistes sont également plus enclins à utiliser le « like » pour diffuser leurs idées, jouant sur l’attrait émotionnel pour capter l’attention. Les publications contenant des messages d’extrême-droite, par exemple, reçoivent en moyenne 20% plus de « likes » que les publications neutres . Ce déséquilibre des contenus polarisants conduit à une diffusion massive de messages qui ne représentent pas nécessairement la majorité, mais qui vont l’influencer.
Articles sur le thème « Politique »
Le « like » émotionnel : quand l’engagement est motivé par les émotions
Les réseaux sociaux favorisent en priorité les publications qui génèrent des émotions fortes, qu’elles soient positives ou négatives. Ainsi, les posts suscitant des réactions viscérales – violence, injustice, images marquantes – dominent les fils d’actualité. « Les contenus qui provoquent des émotions comme la colère ou l’amusement ont 30 % plus de chances d’être partagés », relève une étude de l’Université de Californie . Dans ce cadre, des causes peu « spectaculaires », comme les droits des minorités ou les enjeux environnementaux sans aspect sensationnel, sont moins « likées » et donc reléguées en arrière-plan.
Ce déséquilibre illustre un biais structurel des algorithmes : ils privilégient les contenus qui captent rapidement l’attention, souvent au détriment des débats constructifs ou des causes humanistes. Le « like » se révèle ainsi un geste à l’apparence anodine, mais qui influe profondément sur le type d’informations qui atteignent le public, et donc les politiques.
« Liker » est un acte politique à assumer
Le « like » est un acte politique. Chaque clic est un choix de visibilité, une adhésion à une vision du monde et à des valeurs. Face à cette réalité, il devient essentiel de reconsidérer l’acte de « liker » et de réfléchir à ce que nous voulons voir émerger dans la sphère publique. Les posts humoristiques, polémiques ou qui exploitent l’émotion bénéficient actuellement d’une visibilité démesurée, tandis que des sujets importants sont trop souvent noyés sous les algorithmes.
Si « liker » est devenu un acte de soutien, il est aussi un acte de responsabilité. En s’interrogeant sur la nature de ce que l’on « like » et pourquoi, chacun peut agir pour promouvoir un espace public numérique plus équilibré et représentatif des enjeux majeurs de demain.
