Pourquoi remplacer « vulgarisation scientifique » par « médiation scientifique » ?
La vulgarisation scientifique est souvent perçue comme un processus vertical : le scientifique, détenteur du savoir, transmet des informations simplifiées à un public considéré comme profane. Cette approche « top-down » reflète une vision paternaliste et unidirectionnelle de la communication scientifique. En revanche, la médiation scientifique propose une démarche plus horizontale et participative, où le dialogue remplace la simple transmission.
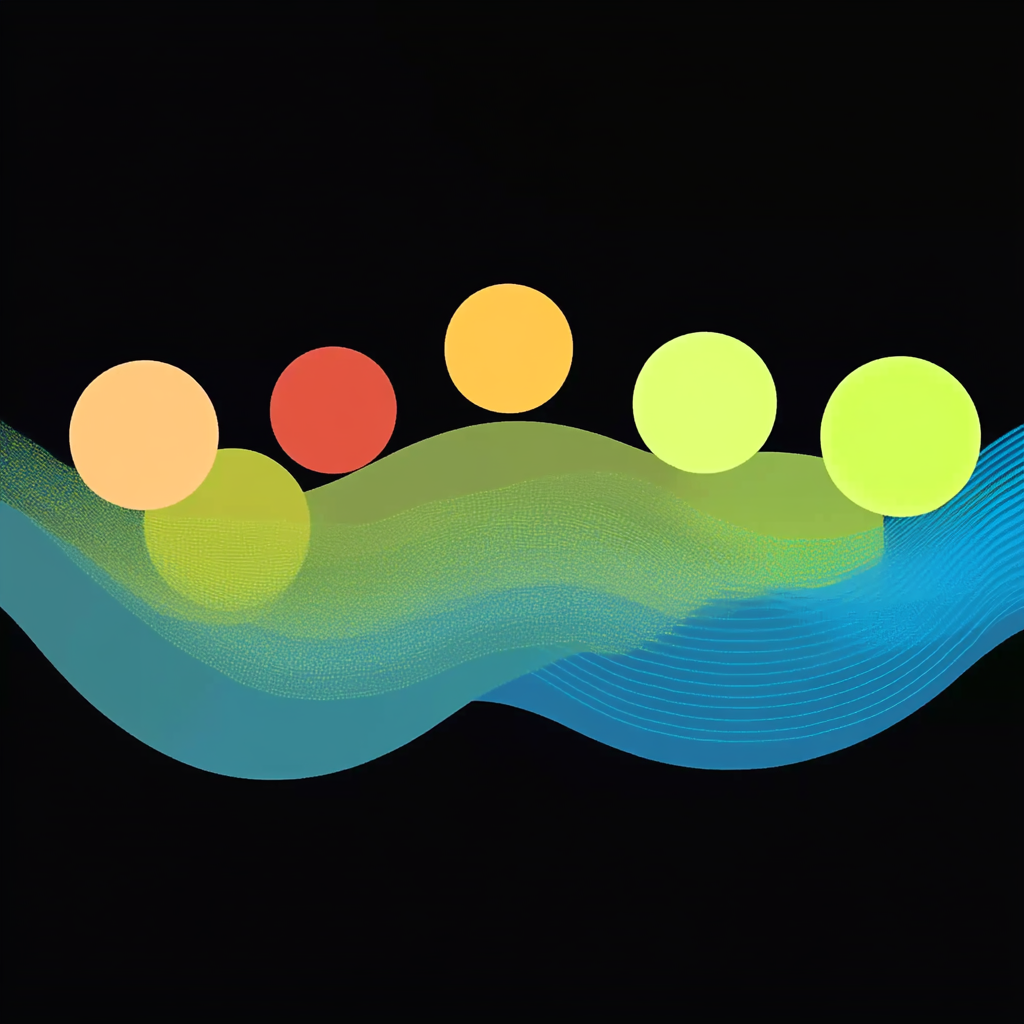
La vulgarisation : une approche limitée
Le terme « vulgarisation » vient du latin vulgaris, signifiant « destiné au commun ». Historiquement, il a impliqué une simplification destinée à rendre accessible un savoir complexe, mais il peut renforcer une distance sociale et cognitive entre experts et public. Par ailleurs, cette méthode ignore souvent les contributions « bottom-up » issues de la société elle-même. Nombre de découvertes scientifiques, comme celles des sciences citoyennes (science participative), émergent de l’observation ou de la participation active des non-scientifiques (par exemple, dans l’étude de la biodiversité ou le suivi du changement climatique).
La médiation scientifique : vers un dialogue constructif
La médiation scientifique, apparue dans les années 1970 et renforcée dans les années 1990, est une réponse aux critiques envers une science perçue comme éloignée du public. Elle vise à inclure les citoyens en tant que participants actifs dans la production et l’interprétation des connaissances. Contrairement à la vulgarisation, elle ne se limite pas à transmettre une vérité : elle ouvre un espace de dialogue et de co-construction où scientifiques et publics échangent sur des savoirs, des doutes et des perspectives
Cette démarche est cruciale face aux défis contemporains, où la confiance en la science vacille et où la désinformation prolifère. Elle ne cherche pas seulement à « convaincre », mais à outiller le public pour exercer un esprit critique, fondé sur la démarche scientifique elle-même.
Cela inclut :
- Apprendre à analyser les sources d’information,
- Comprendre les incertitudes inhérentes aux recherches,
- Développer une posture de questionnement actif
Inégalités d’accès : un enjeu clé
L’accès à la vulgarisation scientifique est souvent inégal, favorisant des publics déjà éduqués ou curieux. À l’inverse, la médiation cherche à inclure des publics diversifiés et à réduire ces barrières. Elle peut ainsi renforcer l’engagement citoyen et la compréhension mutuelle entre science et société
Pourquoi la médiation ?
- Renforcement de la démocratie scientifique : Inclure le public dans les débats scientifiques et technologiques contribue à des décisions plus éclairées et légitimes.
- Meilleure acceptation sociale des innovations : En engageant les citoyens dès le départ, la médiation permet une appropriation des enjeux scientifiques.
- Résilience face à la désinformation : En enseignant comment « penser scientifiquement », la médiation permet aux individus de distinguer faits et croyances.
Citations et références
Les recherches en science participative montrent que les projets impliquant des citoyens dans la collecte et l’analyse de données peuvent enrichir les savoirs scientifiques tout en sensibilisant aux problématiques sociétales
Par exemple, l’Observatoire des Saisons ou les initiatives liées à l’Ambroisie, une plante invasive, mobilisent des acteurs non spécialistes pour générer des données d’une grande valeur scientifique.
Les mots façonnent nos représentations
Changer de termes, ce n’est pas anodin. Les mots que nous utilisons structurent la manière dont nous percevons et interagissons avec le monde. Utiliser le terme vulgarisation sous-entend une hiérarchie implicite, où le savoir descend de ceux qui savent vers ceux qui ignorent. Cette représentation peut décourager le public de participer activement ou même de remettre en question l’information transmise.
À l’inverse, médiation scientifique évoque un processus de mise en relation, de co-construction et de partage. Cela modifie les attentes et les dynamiques : il ne s’agit plus de « simplifier pour expliquer », mais d’instaurer un dialogue où chacun peut contribuer. Cette perspective est essentielle pour renforcer la place des citoyens dans les débats scientifiques contemporains, tout en les outillant pour comprendre les incertitudes propres à la recherche scientifique
Lire d’autres articles sur la médiation scientifique
Le pouvoir des mots est bien documenté. Comme le souligne le linguiste George Lakoff, « les mots encadrent notre pensée et nos décisions ». Ainsi, choisir médiation scientifique permet de déplacer le cadre mental, d’une posture descendante à une interaction d’égal à égal. Ce changement s’inscrit également dans une évolution plus large des sciences, visant à intégrer les savoirs locaux et citoyens dans les processus de recherche et de décision
Passer de la vulgarisation à la médiation scientifique, c’est reconnaître que la science est une démarche collective, enrichie par le dialogue entre experts et citoyens. Ce changement de paradigme permet non seulement de rapprocher la science de la société, mais aussi de renforcer sa pertinence et sa légitimité dans un monde en mutation rapide.
